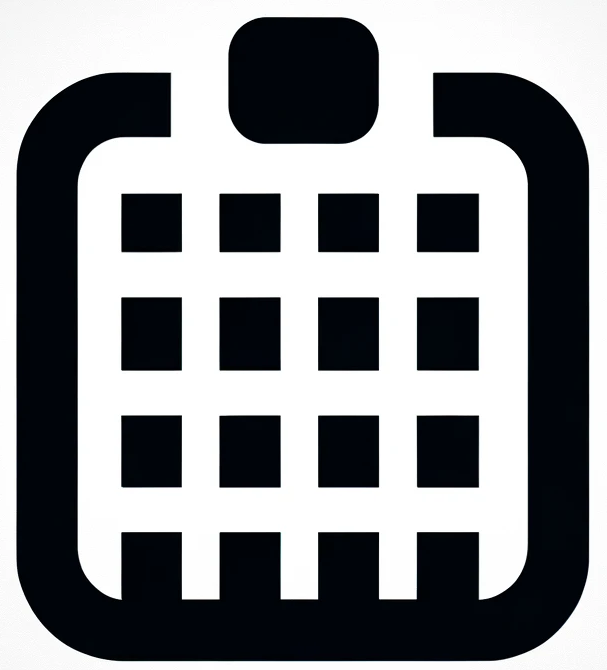La SLP, un statut accessible sous conditions
La Société de Libre Partenariat (SLP) représente une forme juridique méconnue du grand public, réservée à des professions spécifiques. Cette structure hybride, créée en 2015, permet aux professionnels libéraux de s’associer tout en conservant leur indépendance. Pour savoir ce qu’est une SLP, il faut comprendre qu’elle se distingue des sociétés classiques par sa souplesse de fonctionnement.
Contrairement aux sociétés civiles professionnelles, la SLP offre une responsabilité limitée aux apports. Les associés ne sont pas tenus des dettes sociales au-delà de leur contribution financière. Cette protection juridique constitue l’un de ses principaux atouts face aux formes d’exercice traditionnelles. Le régime fiscal reste transparent : chaque associé est imposé directement sur sa quote-part des bénéfices.
Profils éligibles pour créer une SLP
Seuls les professionnels libéraux réglementés peuvent constituer une SLP. La liste comprend notamment les avocats, notaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes et géomètres-experts. Les professions médicales restent exclues de ce dispositif, conservant leurs propres structures dédiées.
L’activité exercée doit correspondre exactement à la profession réglementée des associés. Un mélange d’activités différentes n’est pas autorisé dans une même SLP. Par exemple, des avocats ne peuvent s’associer avec des experts-comptables dans cette structure. Cette règle garantit l’homogénéité professionnelle et le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
Conditions de création d’une SLP
La constitution d’une SLP nécessite au minimum deux associés. Aucun capital minimum n’est imposé par la loi, mais les statuts doivent préciser les apports de chaque associé. Ces apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie, selon les besoins de l’activité.
Tous les associés doivent être inscrits au tableau de leur ordre professionnel respectif. Cette inscription conditionne la validité de la société. Les statuts doivent être établis par acte notarié ou sous seing privé, puis déposés au greffe du tribunal de commerce. La publication légale dans un journal d’annonces légales complète les formalités de création.
Démarches administratives étape par étape
La première étape consiste à rédiger les statuts en précisant l’objet social, la durée, le siège social et les modalités de fonctionnement. L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés intervient ensuite, accompagnée du dépôt d’un dossier complet au Centre de Formalités des Entreprises.
Les déclarations fiscales suivent un calendrier précis. Vous devrez transmettre la déclaration de résultats dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. Chaque associé recevra un relevé de quote-part lui permettant de déclarer sa part de bénéfices dans sa déclaration personnelle. L’administration sociale nécessite également une attention particulière selon le statut de chaque associé.
Investir dans une SLP existante
L’entrée dans une SLP existante s’effectue par acquisition de parts sociales auprès d’un associé sortant ou par augmentation de capital. Les statuts fixent généralement les conditions de cession et d’agrément des nouveaux associés. L’ordre professionnel peut imposer des règles spécifiques concernant l’admission de nouveaux membres.
Le nouvel associé acquiert les mêmes droits et obligations que les membres fondateurs. Il participe aux décisions collectives et assume sa part de responsabilité dans la gestion. L’évaluation des parts s’appuie sur la valeur de l’actif net comptable, parfois ajustée selon les méthodes d’évaluation prévues aux statuts.
Gestion et fonctionnement au quotidien
La gestion d’une SLP repose sur les règles fixées dans les statuts. Les décisions courantes peuvent être prises par un gérant désigné, tandis que les décisions importantes nécessitent l’accord des associés. Le régime de la transparence fiscale simplifie les obligations déclaratives au niveau de la société.
La dissolution peut intervenir pour plusieurs motifs : expiration du terme, réalisation de l’objet social, ou décision des associés. La liquidation suit les règles du droit commun des sociétés, avec distribution de l’actif net entre les associés proportionnellement à leurs droits. Cette étape nécessite l’intervention d’un liquidateur et le respect de formalités spécifiques de radiation.