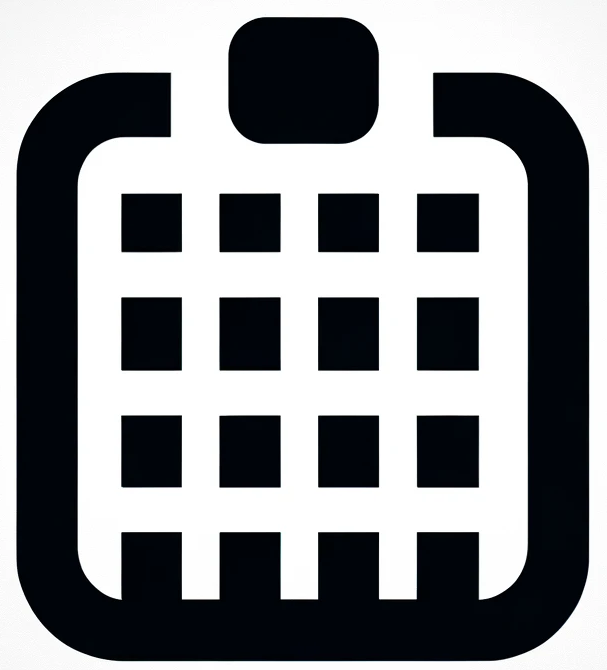La fin d’une époque s’annonce dans le secteur bancaire français. Dès novembre prochain, les établissements financiers devront respecter un plafond strict de 850 euros pour leurs frais de succession, mettant fin à des décennies de tarification libre qui pouvait atteindre plusieurs milliers d’euros. Cette révolution tarifaire, officialisée par un décret du 14 août, transforme radicalement la gestion des héritages bancaires.
Jusqu’à présent, les banques appliquaient leurs propres grilles tarifaires selon des critères opaques. Une succession de 200 000 euros pouvait générer jusqu’à 2 000 euros de frais, soit 1% du patrimoine détenu. Cette liberté tarifaire touchait particulièrement les familles modestes : certains établissements prélevaient 300 euros forfaitaires dès le premier euro sur un compte, transformant la gestion d’un petit héritage en véritable gouffre financier.
Le nouveau cadre réglementaire distingue clairement les situations. Les successions les plus simples bénéficient désormais d’une gratuité totale : héritages de mineurs, soldes inférieurs à 5 910 euros, ou dossiers administrativement simples où les héritiers sont connus et identifiés. Pour les successions complexes impliquant des crédits en cours, des héritiers multiples ou des situations familiales compliquées, le plafond de 850 euros s’applique systématiquement, même si 1% du patrimoine dépasse ce montant.
Une réforme née de scandales et de mobilisation citoyenne
Cette transformation législative résulte d’une pression croissante de l’opinion publique et des associations de consommateurs. L’affaire emblématique d’une famille contrainte de payer 138 euros pour clôturer le livret A de leur enfant décédé en 2021 avait cristallisé les critiques. L’UFC-Que Choisir révélait par ailleurs que ces frais avaient augmenté de 50% en douze ans, atteignant en moyenne 303 euros toutes banques confondues.
Les disparités entre établissements défrayaient la chronique : pour une succession identique de 20 000 euros, les frais oscillaient entre 80 euros et 527 euros. Cette anarchie tarifaire contrastait avec la gratuité pratiquée par quelques établissements. La Fédération bancaire française justifie encore ces écarts par la complexité administrative : vérification des actes de décès, échanges avec les notaires, déclarations fiscales, gel des avoirs. Selon elle, le traitement d’une succession mobilise des équipes spécialisées pendant sept mois en moyenne.
Des perspectives d’évolution du secteur bancaire
Cette réglementation s’inscrit dans une tendance plus large d’encadrement des pratiques bancaires. Après le plafonnement des frais d’incidents et la régulation des comptes inactifs, le législateur resserre son contrôle sur un secteur accusé de profiter des moments de vulnérabilité de ses clients. Le montant de 850 euros sera révisé annuellement selon l’inflation, garantissant l’adaptation de la mesure dans le temps.
Pour les banques, cette contrainte impose une restructuration de leurs processus. Elles devront compenser la baisse de revenus par une optimisation de leurs coûts : dématérialisation accrue, automatisation des procédures, rationalisation des équipes dédiées. Cette évolution pourrait paradoxalement améliorer l’efficacité du secteur en le contraignant à moderniser ses méthodes plutôt qu’à compter sur des rentes tarifaires. Les 200 millions d’euros de revenus annuels générés par ces frais représentent désormais un enjeu de productivité plutôt qu’un simple levier de tarification.