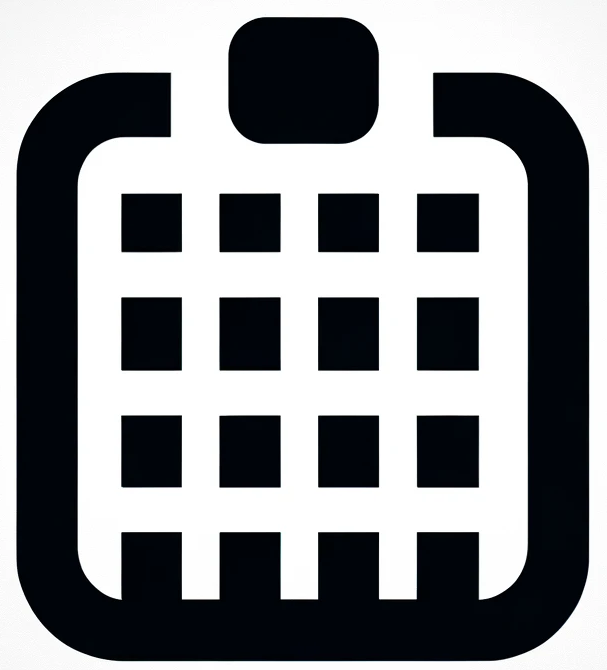Le Trésor public a officiellement confirmé qu’une réflexion était en cours concernant l’abandon du chèque comme moyen de paiement des impôts et amendes. Cette annonce du 4 août 2025, faite par la Direction générale des finances publiques, marque une étape décisive dans la disparition programmée de ce vestige du siècle dernier.
L’effondrement des chiffres justifie amplement cette démarche. Les données du ministère révèlent une chute vertigineuse de 72% en dix ans du nombre de chèques encaissés par les services publics, qui ne totalisent plus que 39 millions d’unités en 2024. La tendance s’accélère encore en 2025, avec une nouvelle baisse de 20% enregistrée sur les quatre premiers mois de l’année.
Cette évolution reflète un mouvement national plus large. Alors qu’en 2000, les chèques représentaient encore 37% de l’ensemble des transactions scripturales françaises, leur part s’est effondrée sous la barre des 3% aujourd’hui. Au Trésor public, seuls 4,5% des paiements s’effectuent désormais par chèque, ne représentant qu’environ 1% des montants totaux encaissés.
Une révolution dans les habitudes de paiement
La modernisation des comportements financiers explique cette mutation. Les Français ont massivement adopté la carte bancaire, qui concentre désormais 66% de leurs transactions selon SumUp. Cette préférence s’accompagne d’un essor spectaculaire des solutions numériques : virements instantanés, paiements sans contact, portefeuilles électroniques et applications mobiles.
Chez les jeunes générations, la rupture est particulièrement marquée. Seuls 43% des 18-24 ans utilisent la carte comme moyen principal, privilégiant à 22% les paiements mobiles – contre seulement 4% des plus de 65 ans. Cette fracture générationnelle annonce l’accélération du déclin du chèque dans les années à venir.
L’administration fiscale a d’ailleurs anticipé cette évolution depuis plusieurs années. Depuis 2019, les paiements d’impôts supérieurs à 300 euros ne peuvent plus s’effectuer par chèque. Cette restriction technique s’accompagne toutefois d’une tolérance : en cas de difficultés particulières, les contribuables peuvent encore solliciter une dérogation.
Vers la fermeture du dernier centre de traitement
La logistique suit cette évolution. Après la fermeture des centres de traitement de Lille et Créteil en 2023, seul celui de Rennes demeure opérationnel. Selon les informations syndicales, cet ultime site pourrait cesser ses activités dès 2027, actant définitivement la fin de l’acceptation des chèques par l’État.
Cette perspective soulève néanmoins des préoccupations sociales. La CGT et la CFDT dénoncent la suppression programmée d’une cinquantaine d’emplois et plaident pour des mesures d’accompagnement. Elles soulignent également le risque d’exclusion des populations les plus fragiles, notamment les personnes âgées ou défavorisées qui demeurent attachées aux supports papier.
Au-delà des considérations humaines, cette transformation répond à des impératifs économiques et sécuritaires. Les chèques génèrent les coûts de traitement les plus élevés et constituent le moyen de paiement le plus exposé à la fraude. En 2020, 538 millions d’euros ont été détournés via ce canal, plaçant le chèque en tête des supports frauduleux devant tous les autres moyens de paiement.
Cette mutation française s’inscrit dans un mouvement européen plus vaste. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la République tchèque ont déjà abandonné le chèque depuis les années 2000. Dans l’Union européenne, ce moyen de paiement ne représentait plus qu’1% des transactions en 2022, la France concentrant à elle seule 88% des chèques encore émis sur le continent.
L’adaptation progressive permettra d’éviter les ruptures brutales. Le Trésor public développe les alternatives : prélèvements automatiques, virements, paiements en espèces chez les buralistes partenaires et dans les centres publics. L’objectif affirmé consiste à préserver l’accessibilité des services publics tout en accompagnant cette transition technologique désormais inéluctable.